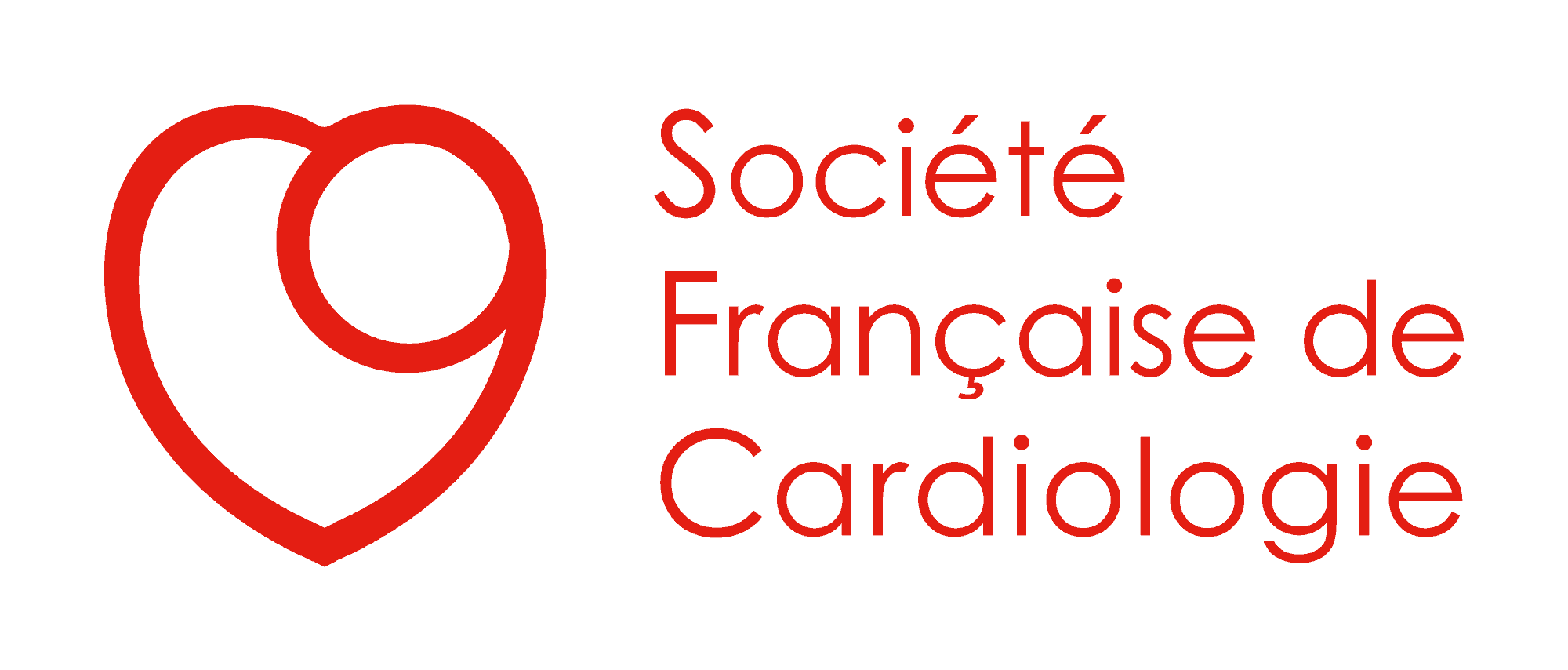Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Découvrez les propositions des experts de la SFC émises à partir d’une revue de la littérature et de leur expérience, autour de sujets d’actualité n’ayant pas fait l’objet de recommandations précises.
Voici un aperçu rapide des sujets abordés dans cette publication :
Dernières publications
Publications
Consensus d’experts sur l’HTA, hormones et femme
Voici un aperçu rapide des sujets abordés dans cette publication :
Consensus d’experts de la Société Française d’Hypertension Artérielle (SFHTA) de la SFC
Avec le partenariat du Collège des Enseignants de Gynécologie Médicale (CEGM), du Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire (CEMV), du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF), de la Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie Médicale (FNCGM), du Groupe d’Étude sur la Ménopause et le vieillissement Hormonal (GEMVI), de la Société Française d’Endocrinologie (SFE), de la Société Française de Médecine Vasculaire (SFMV), de la Société Francophone de Néphrologie Dialyse et Transplantation (SFNDT)
Introduction
Le risque d’hypertension artérielle (HTA) augmente avec l’âge mais avec des différences selon le sexe. L’HTA est une maladie rare chez les individus, hommes ou femmes, avant 50 – 60 ans, étant moins fréquente chez les femmes que chez les hommes. Les données épidémiologiques françaises récentes de l’étude ESTEBAN (BEH 2018) retrouvent une dégradation de la situation en matière d’HTA chez les femmes par rapport à 2006. On observe à la fois une augmentation du niveau moyen de la pression artérielle, conjointement à une augmentation de la prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité, ainsi qu’une moindre proportion de femmes hypertendues traitées par antihypertenseurs chez les femmes dès 55 ans.
Parallèlement, l’incidence des maladies cardio-vasculaires chez la femme est beaucoup plus faible que chez l’homme, puis augmente rapidement après la ménopause. L’hypothèse longtemps discutée pour expliquer cette plus faible incidence des pathologies artérielles chez la femme jeune a été celle de l’effet protecteur des estrogènes endogènes. La carence estrogénique lors de la ménopause est un des nombreux facteurs (génétiques, immuno-enzymatiques, facteurs de risque confondants) pouvant expliquer la majoration significative du risque cardio-vasculaire et métabolique chez les femmes après 50 ans. Les mécanismes par lesquels la carence estrogénique augmente le risque de l’HTA incluent notamment la perte de l’effet protecteur vasodilatateur et antiprolifératif des estrogènes endogènes sur les vaisseaux et la survenue d’une hyperandrogénie relative qui contribue à l’élévation de la pression artérielle (PA) après la ménopause. Il s’en suit conjointement l’apparition d’un syndrome métabolique avec insulino-résistance qui participe à la genèse de cette hypertension artérielle.
Malgré ces considérations physiopathologiques et les études épidémiologiques en faveur du rôle bénéfique du traitement hormonal de la ménopause (THM) sur la pression artérielle et le risque cardio-vasculaire chez la femme récemment ménopausée, les premiers essais randomisés, avec des traitements prescrits par voie orale, ont plutôt montré une augmentation de ce risque cardio-vasculaire. De plus, il n’a pas été clairement démontré que le THM réduisait le niveau de pression artérielle. L’effet du THM par voie transdermique était neutre. En réalité, les effets des estrogènes exogènes sur le vaisseau dépendent non seulement du type d’estrogène, de sa posologie et de sa voie d’administration, mais également de la présence (effets plutôt délétères) ou non (effets plutôt bénéfiques) d’athérome vasculaire pré-existant. De ceci découle la notion de fenêtre d’intervention pour le traitement hormonal de la ménopause qu’il convient de discuter chez la femme de moins de 60 ans, récemment ménopausée (< 10 ans), en prévention primaire, et dont le risque cardio-vasculaire est contrôlé. Par ailleurs, l’impact de la molécule progestative associée à l’estrogénothérapie chez la femme non hystérectomisée, doit être prise en compte.
Les spécificités de la femme concernant le risque d’HTA et le débat quant aux bénéfices et risques du THM chez la femme ménopausée hypertendue nous ont conduits à proposer un consensus d’experts de la Société Française d’Hypertension sur les spécificités de la prise en charge de l’HTA de la femme. Deux phases clés hormonales, la contraception et la ménopause ont été prises en compte avec l’impact des traitements exogènes hormonaux, la grossesse ayant fait l’objet d’un consensus spécifique en 2016.
Sommaire
- Introduction
- Méthode
- Épidémiologie – Différences Homme / Femme (avant et après la ménopause)
- HTA et risque cardiovasculaire de la femme
- Hygiène de vie et HTA chez la femme – Spécificités féminines du traitement non médicamenteux
- Spécificités du traitement médicamenteux antihypertenseur chez la femme
- HTA secondaires chez la femme
- Hypertension artérielle et contraception
- HTA et ménopause
- HTA et traitement hormonal de la ménopause (THM)
- HTA et traitements non hormonaux de la ménopause
- Parcours de soins de la femme hypertendue
Date de mise à jour du document : Décembre 2018
Document validé par la Commission Documents de Consensus
Cette commission de la SFC a pour objectif de superviser et contrôler la préparation des documents scientifiques ou d’autres documents tels que les consensus d’experts ou prises de position.
Partagez cet article :
Partagez cet article :
Written by : SFC
Plus de publications de la SFC

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE New Threshold for Defining Mild Aortic Stenosis Derived From Velocity-Encoded MRI in [...]

CARDIOLOGIE PÉDIATRIQUE The Cardiovascular Care of the Pediatric Athlete | Lire l'article JACC CARDIO-ONCOLOGIE [...]